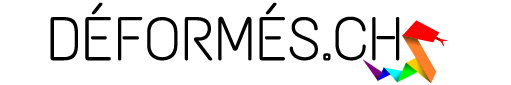Quand le négationnisme, la banalisation et la concurrence victimaire font le buzz
Lors de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 27 janvier 2017, le président Donald Trump a rendu hommage aux victimes sans mentionner spécifiquement qu’elles étaient juives. Quelques mois plus tard, c’est la candidate du Front national aux élections présidentielles françaises Marine Le Pen qui déclare que la France n’est pas responsable de la rafle du Vél d’Hiv, la plus grande arrestation massive de Juifs en France qui a eu lieu au mois de juillet 1942. En 2015, un élu du Mouvement citoyen genevois compare une manifestation devant le centre culturel alternatif, l’Usine, à la Nuit de Cristal, ce pogrom contre les juifs où près de 200 synagogues ont été détruites, 7’500 commerces saccagés et 30'000 juifs déportés. Ce genre de dérapages apparaît régulièrement dans la bouche de certains politiciens, immédiatement relayés par les médias.
Pour décrire ce phénomène, l’historienne américaine Deborah Liebstadt parle de «softcore denial», qu’on peut traduire par «négationnisme soft». Ce concept est-il pertinent? «Je préfère parler de propos banalisateurs. Le concept de "négationnisme soft" m’échappe. Le négationnisme ne peut se concevoir "soft" ou "hard", il ne s’agit pas d’un exercice stylistique. Le négationnisme c’est la négation du génocide, un déni des faits historiques pour porter préjudice à la mémoire des victimes en tentant de gommer les atrocités commises. Le négationnisme est heureusement puni par l’article 261 bis du Code pénal en Suisse et par la loi Gayssot, en France. Les propos de ces politiciens s’apparentent donc plutôt à une banalisation de la Shoah», explique Johanne Gurfinkiel, le secrétaire général de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation (CICAD).
Un conflit sémantique
«L’idée d’un négationnisme soft est au fond aussi étrange que celle d’un extrémisme modéré. Il y a un conflit sémantique entre les termes qui est exploité pour stigmatiser la banalisation du mal», explique de son côté le linguiste Thierry Herman, maître d’enseignement et de recherche aux Universités de Lausanne et Neuchâtel. Selon lui, Marine Le Pen joue sur l’ambiguïté du référent lié au mot "France": «La stratégie rhétorique est bien connue: il s’agit de dissocier la lettre de l’esprit. Lorsqu’elle évoque la France, Marine Le Pen a expliqué rétrospectivement vouloir faire référence à l’âme de la vraie France et non à celle de Vichy, responsable du Vél d’Hiv.»
Peut-on qualifier d’antisémites ce genre de dérapages? Pour Thierry Herman ces propos relèvent avant tout du discours populiste: «Il s’agit de ne pas se profiler dans la continuité de la politique menée jusqu’ici, mais de provoquer le système en jouant avec les limites, sinon en les dépassant, dans cette visée de différentiation des autres partis politiques». Johanne Gurfinkiel ne dit pas le contraire: «Ces dérapages sont avant toute chose une forme de sottise. Il s’agit d’attirer l’attention quitte à choquer. On fait immanquablement le buzz en parlant ainsi de la Shoah et des camps d’extermination. La conséquence de cette banalisation ébranle, à terme, l’ensemble des travaux menés sur la transmission de la mémoire. C’est pourquoi, la CICAD réagit systématiquement dans ce type de situation pour rappeler que ces paroles prononcées engagent la responsabilité de l’émetteur du message.»
Banaliser pour se déculpabiliser
Au-delà d’une volonté de créer un buzz médiatique, «la banalisation fait partie d’un mécanisme de confrontation à la culpabilité», analyse Jacques Ehrenfreund, professeur d’histoire du judaïsme, à l’Université de Lausanne. Selon ce chercheur, le cas de l’écrivain allemand Günter Grass, prix Nobel de littérature et ancien SS, illustre particulièrement bien ce comportement. Au printemps 2012, Günter Grass publie un poème dans lequel il s’interroge sur les raisons qui le retiennent de dénoncer un génocide que l’Etat d’Israël s’apprêterait à commettre à l’encontre de l’Iran: «Si on se demande pourquoi cet auteur a écrit ce poème, on ne peut pas manquer de comprendre qu’en réalité, la seule manière pour cet ancien SS d’apaiser son sentiment de culpabilité consiste à assigner aux Juifs un potentiel de destruction aussi fort que celui dont ils ont été victimes. Il échappe à la culpabilité par une stratégie qui consiste à élargir le cercle des coupables jusqu’aux victimes, donc à l’infini», explique le professeur.
«Ce n’est pas du négationnisme, mais ce procédé pervers est presque aussi dangereux, car il nie la réalité de ce qu’a été le nazisme». Une autre forme de banalisation se retrouve dans la concurrence victimaire: «Ce nouvel antisémitisme, dont Dieudonné est l’incarnation, stipule que les juifs usurpent une souffrance tout en en privant les autres minorités victimes». Depuis les années 1980, l’Europe a construit une politique historique et mémorielle de transmission du savoir au sujet de la Shoah. «Aujourd’hui, le nouvel antisémitisme repose précisément sur l’affirmation que par cette politique les juifs auraient réussi à capter indûment toute l’attention du monde pour leurs malheurs, confisquant en quelque sorte la misère des autres», avance Jacques Ehrenfreund.
Cette position à l’intersection du négationnisme et de la concurrence victimaire atteint son paroxysme dans l’ouvrage censuré de l’écrivain français Roger Garaudy, «Les mythes fondateurs de la politique israélienne», publié en 1995. Dans ce livre, l’auteur stipule que la Shoah est un mythe inventé par les Juifs dans le but d’obtenir l’aide de la communauté internationale, afin de créer un état, Israël, lui-même en train de commettre un génocide. «S’il y a de bonnes raisons de penser que le négationnisme a échoué, ce courant de relativisation monte indéniablement en puissance. Je ne suis pas certain qu’on arrive à continuer de transmettre la mémoire de la Shoah, quand tous les survivants auront disparu.»