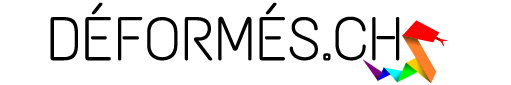L’histoire américaine au cœur d’une guerre culturelle
Le 8 novembre, aux Etats-Unis, ont eu lieu les élections de mi-mandat, ou midterms. Il faudra attendre le mois de décembre pour savoir si les démocrates parviennent à conserver leur majorité au Congrès, deux ans après l’élection de Joe Biden. En effet, l’Etat américain de Géorgie devra voter à nouveau en décembre pour désigner l’un des sénateurs au Congrès après qu’aucun des candidats n’a atteint la barre des 50%, ont rapporté le 9 novembre plusieurs médias américains, dont CNN et NBC.
Le sénateur sortant, le pasteur démocrate Raphael Warnock sera de nouveau opposé à l’ancienne star du football américain Herschel Walker, soutenu par Donald Trump, dans un scrutin sans troisième candidat cette fois-ci, qui pourrait fixer la majorité à la chambre haute du Congrès.
Du droit à l’avortement à l’éducation, en passant par les droits des homosexuels et la place de la religion dans la société, nombreux sont les sujets qui font l’objet d’une opposition binaire aux Etats-Unis. Même l’histoire est concernée par cette opposition frontale. Le point sur cette «guerre culturelle» avec l’historien Nicolas Barreyre, maître de conférences à l’Ecole des hautes études en sciences sociales et auteur de L’Or et la Liberté. Une histoire spatiale des Etats-Unis après la guerre de Sécession (Ed. EHESS, 2014).
D’où provient cette notion de «guerre culturelle»?
La nation américaine, comme tous les Etats-nations occidentaux, s’est construite en s’adossant à une certaine écriture de l’histoire, ce que l’on appelle en France le «roman national» . Cette histoire, aux Etats-Unis, repose sur un certain nombre de grands mythes – le Mayflower, les Pères fondateurs, la conquête de l’Ouest, le melting pot… – qui résonnent encore fortement dans les imaginaires.
Cette vision de l’histoire, véhiculée de génération en génération, a été largement contestée lors du mouvement des droits civiques des années 1950 et 1960, car elle passait sous silence des pans entiers de la population – les Amérindiens, bien sûr, mais aussi les femmes, les Noirs et les Hispaniques. Or cette remise en cause a été mal vécue par un grand nombre d’Américains, mal à l’aise avec les profonds changements de la société. C’est dans ce contexte qu’en réaction au mouvement des droits civiques, certains élus républicains, puis le parti dans son ensemble, ont jeté les bases d’une nouvelle stratégie électorale centrée autour de la «guerre culturelle».
Que recouvre exactement cette expression?
Tout part du constat pragmatique que font certains stratèges républicains à partir des années 1980: les élections ne se gagnent plus au centre, en tentant de convaincre les électeurs indécis, mais avant tout en mobilisant ses militants et en démobilisant ceux du camp adverse. Pour cela, il est profitable d’amener les électeurs à se positionner sur des questions portant à controverse, afin de fédérer ses propres troupes – c’est à cette époque que l’interdiction du droit à l’avortement devient une priorité pour le Parti républicain.
La guerre culturelle va aussi s’étendre à l’histoire, essentiellement autour de la mémoire de la guerre de Sécession (1861-1865) . Encore aujourd’hui, elle suscite de fortes tensions dans le pays, quand ce ne sont pas des affrontements violents, comme à Charlottesville, en 2017. Le rassemblement pour protester contre le retrait de la statue du général confédéré Robert Lee avait entraîné la mort d’une contre-manifestante.
Pourquoi la guerre de Sécession cristallise-t-elle ces tensions?
Ce que l’on appelle guerre de Sécession en France est connu sous le nom de Civil War, «guerre civile» , aux Etats-Unis. Rappelons le contexte: dans les années 1850, un intense conflit politique oppose les Etats dont l’économie et la société dépendent de l’esclavage – des Etats du Sud produisant surtout du coton – à ceux dans lesquels l’esclavage a été aboli, soit au moment de la révolution américaine, soit graduellement par la suite. Cette confrontation atteint un point de non-retour en 1860, avec l’élection d’Abraham Lincoln, le candidat du jeune Parti républicain, dont le ciment idéologique est alors l’anti-esclavagisme, et dont le programme est d’empêcher l’extension de l’esclavage dans les territoires récemment conquis par les États-Unis.
Craignant que Lincoln, par « tyrannie», ne cherche ensuite à abolir la pratique dans les Etats du Sud, ces derniers font sécession. Cette décision n’est pas reconnue par Washington, et, dans un contexte de tension extrême, l’attaque d’un fort fédéral à Charleston, en Caroline du Sud, déclenche la guerre. Cette guerre dure quatre ans, causant la mort de quelque 750000 Américains, et se termine par la défaite des États confédérés. L’esclavage est aboli aux États-Unis par le 13e amendement à la Constitution. Or, quelques mois à peine après la fin de la guerre, un contre-récit est déjà mis en avant. La «cause perdue» – le nom est tiré de The Lost Cause, livre d’Edward A. Pollard publié en 1866 – dépeint un Sud d’avant-guerre heureux, digne et idyllique, où chacun vit paisiblement à sa place. C’est une image tenace, que l’on retrouve encore plusieurs décennies plus tard dans Autant en emporte le vent, roman de Margaret Mitchell publié en 1936 et triomphalement adapté au cinéma par Victor Fleming trois ans plus tard.
Selon cette lecture de la guerre civile, la cause sudiste n’était pas liée à la défense de l’esclavage mais portait plutôt sur la défense de libertés politiques constitutionnelles, elles-mêmes garantes d’un mode de vie unique. Les historiens ont depuis montré que cette thèse n’était pas conforme à la réalité; les ordonnances de sécession votées par les États du Sud en 1860 et 1861 mentionnent ainsi explicitement la défense de l’esclavage. Mais ce mythe de la cause perdue, d’un Sud épris de liberté tombant après une lutte héroïque sous les coups d’un Nord industriel et tyrannique, a connu un grand succès. Il s’est peu à peu imposé dans l’imaginaire de la majorité blanche, avant d’être contesté lors du mouvement des droits civiques.
C’est à cette époque que les anciens États confédérés basculent dans le camp républicain…
Oui, cela peut sembler étrange aujourd’hui, mais, traditionnellement, le Sud votait démocrate, car le Parti républicain restait le parti honni de Lincoln. Mais alors que les démocrates se font les champions des droits des Noirs, surtout dans les années 1950, Richard Nixon et ses stratèges vont œuvrer à «récupérer» les électeurs sudistes opposés aux droits civiques. Pour ce faire, ils comprennent rapidement l’utilité politique de la guerre de Sécession. Célébrer la mémoire du conflit et de la «cause perdue» permet en effet de fédérer un vaste électorat qui va des suprémacistes blancs aux conservateurs.
Le souvenir de cette guerre civile s’est cristallisé autour d’un certain nombre de symboles, que l’on peut mobiliser dans le discours public. Le plus célèbre d’entre eux est sans doute le drapeau confédéré, lourd de sous-entendus politiques, comme un signe que l’on envoie à ses amis et ses ennemis – ce n’est pas un hasard s’il a été brandi dans le Capitole, siège de la démocratie américaine, lors de l’assaut du 6 janvier 2021. Arborer ce drapeau, aujourd’hui, revient à lancer un message codé, à la fois menaçant pour les Noirs américains et signe de ralliement pour «l’Amérique blanche».
Si le déploiement de ce drapeau et la présence de statues de généraux confédérés ont suscité des condamnations croissantes dans le pays – un tournant a été l’attaque terroriste contre une église noire à Charleston, en 2015, car le tireur avait publié plusieurs photographies sur lesquelles il brandissait un drapeau confédéré –, le fond du problème demeure. Au-delà de la guerre de Sécession, c’est en effet la question du poids de l’esclavage dans la société américaine qui se pose, ainsi que celle d’une longue culpabilité liée à l’asservissement de millions d’êtres humains. Une question que tout un pan de la population refuse de poser, alors que les travaux de certains historiens voient dans l’esclavage un «péché originel » continuant de hanter les Etats-Unis, entraînant régulièrement des accès de violence.
La «Reconstruction», période méconnue de l’histoire américaine, avait pourtant tenté d’agir à ce sujet…
Ce que les historiens nomment la Reconstruction débute au lendemain de la guerre de Sécession et s’achève en 1877. C’est une tentative de rebâtir les institutions politiques du Sud, pour éviter qu’elles ne mènent à l’avenir à une nouvelle sécession. La Reconstruction va de pair avec un profond questionnement sur la notion de citoyenneté, car elle se heurte à une réalité démographique incompressible: la population des ex-États confédérés s’élève à dix millions d’habitants, dont quatre millions d’ex-esclaves qui, du jour au lendemain, sont devenus des hommes et des femmes libres. Que faire d’eux? Des citoyens à part entière, donc leur octroyer le droit de vote? Les débats se déroulent dans un climat politique délétère, dans un Sud ruiné (d’autant plus que l’abolition de l’esclavage a été inconditionnelle, sans indemnités pour les planteurs), détruit en partie, dont les élites viscéralement hostiles au changement cherchent à tout prix à reprendre le pouvoir local.
Certes, la Reconstruction rencontre quelques succès, notamment dans la constitution d’un système d’éducation public, dont vont bénéficier les anciens esclaves, et via l’adoption de plusieurs grands amendements constitutionnels – le 14e amendement (1868) garantit les droits de tous les citoyens et le 15e amendement (1870) interdit la discrimination raciale dans le droit de vote. Mais elle entraîne une réaction extrêmement forte de la part des anciens esclavagistes.
Comment celle-ci se manifeste-t-elle?
C’est à cette époque que naît le Ku Klux Klan, organisation terroriste ayant pour but avoué de défendre la suprématie blanche dans le Sud et de lutter contre la participation des Noirs à la vie politique. Le climat de terreur instauré par le Klan permet la reconquête méthodique du pouvoir par les anciens sécessionnistes et ouvre la voie aux lois ségrégationnistes. Ces dernières sont une arme législative pour assujettir de nouveau les anciens esclaves, et ne seront supprimées dans le Sud que dans les années 1960.
La Reconstruction est donc une période charnière pour qui veut comprendre la société américaine aujourd’hui; en arrière-plan, se pose la question de ce qui constitue le corps politique légitime dans le pays, et quelles en sont les frontières, thématique particulièrement d’actualité depuis le premier mandat de Donald Trump, avec la multiplication des tentatives d’entraver l’accès au vote.
Vous soulignez enfin le rôle joué par l’histoire dans le domaine judiciaire.
C’est notamment le cas à la Cour suprême, plus haute juridiction du pays. Sa composition actuelle consacre le triomphe de l’école «originaliste» , portée en son temps par le juge Antonin Scalia (1936-2016), qui prône une interprétation littérale de la Constitution rédigée en 1787. Il s’agit de rester au plus près des intentions – supposées, parce que le texte même peut donner lieu à des interprétations différentes – des Pères fondateurs. C’est problématique à plus d’un titre, car cette doctrine néglige le fait que des amendements constitutionnels déterminants ont été adoptés depuis 1787, mais surtout parce qu’elle repose sur une vision biaisée, manipulatrice de l’histoire, qui sert à légitimer des renversements de jurisprudence qu’il est malaisé de justifier par la doctrine. En réaction à cela, un juge fédéral a récemment déclaré qu’il aurait dorénavant besoin d’interroger des historiens, car s’il est question de se référer à l’intention originelle des législateurs, alors il faut faire appel à des universitaires… L’histoire constitue donc un champ de bataille idéologique aujourd’hui aux États-Unis.