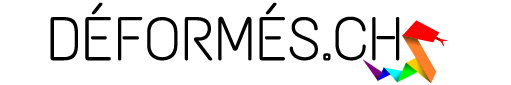Vie et morts de Delphine Horvilleur
La rabbine, il y a encore quelques années, était le nom donné à la femme d’un rabbin. Mais depuis quelque temps, la nouvelle génération appelle Delphine Horvilleur comme ça. Alors, en tant que femme rabbin, l’appellation, désormais, lui convient. Médiatique, juive libérale, philosophe, la jeune femme est de tous les plateaux dès lors qu’il est question de parler de crispation religieuse, de fondamentalisme ou quand l’antisémitisme frappe encore, dans un Hexagone en perpétuelle tension.
Conférencière, directrice de la rédaction de «Tenou’a, Atelier de pensée(s) juive(s)», Delphine Horvilleur sort ces jours «Vivre avec nos morts», un livre de souvenirs dans lequel elle partage le récit de onze deuils personnels ou collectifs. De Simone Weil à un jeune garçon assistant à l’enterrement de son petit frère, pendant lequel elle est officiante, ces textes se veulent une proposition de consolation. Car pour celle qui se définit comme une conteuse, la tentative de lier vie et mort doit se faire par les mots, en comblant le silence de notre incompréhension.
Vous avez eu à célébrer beaucoup d’enterrements durant cette pandémie. Qu’avaient-ils de particulier?
Même si la liturgie était la même, tout était différent. Ce qui compte à un enterrement c’est pouvoir manifester sa présence aux endeuillés, et là on s’est retrouvé dans une situation où les gens ne pouvaient pas se prendre dans les bras, rester ensemble, se retrouver après l’enterrement… Mais je ne m’attendais pas à être confrontée à un phénomène encore plus troublant: depuis cette semaine, je passe un temps considérable dans des cimetières et des synagogues à commémorer la première année de décès de gens morts au début du premier confinement.
Cela prend des formes inédites parce que se retrouvent ensemble des gens qui n’ont pas pu l’être l’année dernière. Notre rapport au temps a changé, parce que l’année de deuil qui s’achève ne clôt rien pour les gens qui n’ont pas pu accompagner leurs morts comme ils auraient souhaité le faire. Tout à coup, c’est comme si le temps ne cessait de se réverbérer sur lui-même.
Vous racontez que petite, votre mère vous interdisait l’accès aux cimetières. Pensez-vous que notre rapport à la mort actuel est le bon? N’est-elle pas trop dissimulée?
On s’est donné l’illusion, la technique médicale aidant, qu’on pouvait tenir la mort à distance, l’installer uniquement aux services de soins palliatifs des hôpitaux. Mais je crois qu’on a un peu oublié à quel point elle était en permanence en dialogue avec nos vies. Quand on se promène dans les rues des capitales européennes, il y a plein d’immeubles sur lesquels est écrit «ici est mort untel», ou «c’est ici qu’est née telle personnalité». On se rend donc bien compte qu’au cours de l’histoire, on a toujours eu bien plus conscience de la mort qui surgissait dans nos vies… Aujourd’hui, la pandémie nous rappelle que la mort n’est jamais sortie de nos vies, bien que nous nous soyons imaginés capables de l’en éclipser presque entièrement.
Selon vous, la peur de la mort est-elle venue d’un monde sécularisé où les réponses face à la mort sont plus qu’incertaines?
Je ne sais pas, car il y a encore, même chez les personnes qui ne croient pas, des éléments de superstition qui subsistent. Un genre de pensée magique qui semble plus grand que soi, et qu’on préfère ne pas sonder de trop près. Je le vois notamment quand j’aborde le sujet de la mort et que les gens se rebiffent, qu’ils refusent d’en parler pour la tenir à distance. Lorsque je demande à des personnes si elles ont dit à leurs enfants quelles étaient leurs dernières volontés, elles me répondent souvent qu’elles ne préfèrent pas le faire, histoire de ne pas angoisser ou déprimer les autres. Mais ce sont finalement des occasions ratées. Il faut parler de la mort à ses proches tant qu’on est encore en capacité à le faire.
Vous racontez une scène primitive de prière, à 10 ans. Vous y suppliez Dieu de ne pas vous laisser mourir, alors que vous venez d’avaler un petit bout de jouet en résine. Votre foi de rabbin a-t-elle encore quelque chose à voir avec cette foi enfantine?
J’ai toujours du mal à parler frontalement de Dieu, car dans la tradition juive, on n’est pas très à l’aise avec ce mot. C’est une tradition qui est moins ancrée sur la foi et le fait de croire que d’autres traditions. La tradition juive est beaucoup plus tournée vers le langage du faire que celui du dire. Toutefois, il est vrai qu’en racontant cette histoire, que je n’avais jamais racontée à personne, je témoigne de la naissance de ma religiosité.
J’ai eu beau théoriser plein de choses, étudier, enseigner, je me rends compte que la petite fille que j’étais à ce moment-là est toujours extrêmement présente, avec ses peurs et ses pensées magiques. C’est à mon avis très important d’avoir accès à l’enfant en soi et qu’il dialogue avec l’adulte qu’on est devenu. À un moment ou l’autre de nos vies, nous redevenons tous l’enfant qui, au coucher du soleil, a besoin qu’on lui raconte des histoires.
Un peu comme ce jeune garçon, qui vous demande où son petit-frère décédé s’en est allé?
Absolument. J’ai eu le sentiment, de façon étrange, d’entendre la voix du Petit Prince, qui demande au narrateur de lui dessiner un mouton. Dans le texte de Saint-Exupéry, il est joliment dit qu’un enfant parviendra toujours à voir l’éléphant avalé par le serpent. Par sa question, cet enfant voulait voir si moi aussi, j’étais capable d’avoir cette vision, puisque les discours adultes ne parvenaient pas à lui donner une explication cohérente et satisfaisante. Porter son frère en terre, ça ne lui convenait pas. Pas simple, alors, de lui expliquer, en tant que rabbin, qu’il n’y a pas de bons mots, et qu’il aurait à entendre plusieurs histoires…
À l’enterrement d’Elsa Cayat, la «psy de Charlie Hebdo», vous dites avoir ressenti la laïcité comme une bénédiction. Pourquoi?
L’enterrement d’Elsa a été un moment particulier, là où, dans le contexte des attentats de janvier 2015, les gens tentaient de nous monter les uns contre les autres. On présentait la situation comme une tension entre les croyants et les non-croyants, les religieux et les non religieux… Mais à cet enterrement, la famille juive d’Elsa et les anticléricaux de Charlie habitaient tous le même monde. On pouvait être sensible au même langage et la laïcité nous permettait cela, car la laïcité affirme que dans son cadre, l’air ne sera jamais saturé par une croyance unique. J’ai appelé cela bénédiction car c’est presque une définition de l’infini, si cher aux traditions religieuses. C’est-à-dire, en somme, qu’il y a toujours plus grand que soi.
En parlant de laïcité, Marina Foïs, aux Césars du cinéma, a regretté qu’un pays laïc tel que la France ait ouvert ses lieux de culte avant ses infrastructures culturelles. Les personnes non-croyantes ne comprendraient-elles plus l’essentialité de la religion pour les croyants?
On pourrait dire ça. Et que c’est encore plus vrai en France plutôt qu’ailleurs, puisqu’il y a chez nous une tradition extrêmement critique à l’égard des religions. Comme si ces dernières étaient un peu poussiéreuses et qu’elles racontaient un monde passé. Toutefois, je dirais quand même un mot pour la défense des artistes, car pour moi, la religion sert à nous transmettre la force de récits. On a tous besoin qu’on nous raconte des histoires qui vont nous faire du bien. Et si la religion remplit cette fonction, la création littéraire et artistique en a aussi le pouvoir. Il est compliqué de définir la culture comme non essentielle, car il a de tout temps été primordial de nous raconter des histoires, qu’elles soient religieuses ou non. Ainsi, culte et culture remplissent parfois des fonctions parallèles.
En Suisse romande notamment, cette période de crise a vu une recrudescence de l’antisémitisme, caractérisée par des attaques contre les synagogues de Lausanne et Genève. Pourquoi, selon vous, ces moments sont-ils toujours synonymes de regain antisémite?
Dans les moments historiques de crise, l’antisémitisme a été une constante. Il se trouve que les juifs ont souvent été taxés d’être des agents contaminants. Au Moyen Âge, on les accusait de contaminer les puits et d’apporter des maladies. Il faut donc être très vigilant puisqu’en temps de crise sanitaire, il y a chez beaucoup de gens un réflexe infantilisant et régressif qui consiste à penser que la contamination vient de l’autre, de l’étranger et donc bien souvent des juifs. Car l’antisémitisme fonctionne toujours main dans la main avec une déresponsabilisation de la société.
Dans votre livre, on comprend que la recherche d’identité vous passionne, mais que vous vous inquiétez des dérives que cette dernière peut prendre aujourd’hui.
Je suis très dérangée par les obsessions identitaires d’aujourd’hui. Surtout quand les gens s’imaginent que l’identité est un retour à la pureté. Je crois que l’identité, c’est exactement l’inverse. L’identité est toujours mouvante et consiste à reconnaître ce qu’on est devenu par rapport à notre point de départ, et comment on a changé. À chaque fois que les gens veulent revenir à l’origine, au fondement et à l’identité pure, ils tombent, au choix, dans le fondamentalisme religieux ou dans les extrémismes.
La métaphore de la pandémie et du virus est particulièrement parlante à ce sujet. Si nous cherchons tous à ne pas être contaminés, nous ne devons pas oublier la contamination dont nous avons besoin: celle des idées. Pour avancer dans l’histoire, il faut donc se laisser contaminer.