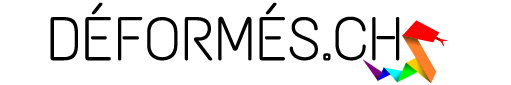Des emplois qui empêchent d’envisager le futur

Comment définissez-vous la notion de précarité?
La notion de précarité compte une composante individuelle, subjective, ce qui la rend un peu difficile à définir. Prenons l’exemple des emplois qualifiés d’atypiques, c’est-à-dire tout ce qui ne correspond pas à une forme d’emploi standardisé (100 %, de 9h à 17h en semaine), soit le travail de nuit, le week-end, sur appel.
Ces formes d’emplois peuvent arranger certaines personnes. Mais si c’est une contrainte, si cela empêche de participer normalement à la société, d’entretenir un cercle d’amis, parce que l’on doit travailler à des moments impossibles, ou si cela empêche de planifier son futur, car on est tout le temps dans une logique de contrats à court terme, bref : si c’est ressenti comme une difficulté, on entre dans une logique de précarité.
Des formes d’emplois en progression, justement…
En matière de précarité, il y a deux vagues. La première fait suite à la crise des années 1990. On a alors assisté à une hausse des emplois sur appel, des emplois le soir, le week-end. Des situations en augmentation statistique jusqu’au début des années 2000. Ensuite, cela s’est un peu stabilisé. Et depuis cinq à dix ans, on observe une sorte de deuxième vague d’emplois précaires; ce sont des jobs dans l’économie de plateformes: les conducteurs Uber, les livreurs de repas, les gens qui offrent des services de différentes sortes au travers d’internet. Je pense que, de nouveau, cela frappe en premier lieu ceux qui n’ont pas les ressources en termes de formation ou qui sont dans des situations difficiles avant la retraite.
La généralisation des jobs d’étudiants?
Oui, même s’il est important de comprendre que c’est un phénomène rythmé par la biographie, c’est un phénomène de parcours de vie. Les étudiants qui sont dans cette situation se disent: «Après les vacances d’été, je peux faire autre chose, je vais avoir ce titre de formation qui me permettra de sortir de ça.» En revanche, pour d’autres, cela devient une précarité à long terme, une situation dont ils savent qu’il va être difficile de sortir.
Un même emploi sera mieux accepté s’il est vécu comme un moyen de financer ses études, un boulot d’été, que si la personne n’a pas le choix. Face à cette diversité, il est parfois difficile pour la recherche de quantifier ces situations.
Justement, dans vos recherches, vous liez précarité et parcours de vie.
Tout à fait, parce que les précarités sont des conditions de vie qui se manifestent de manière plus évidente à certains moments biographiques. Ainsi, l’entrée dans le marché du travail est une sorte de prise de risque. Il en est de même pour la fin de la trajectoire professionnelle, les quelques années qui précèdent la retraite. Et enfin, pour les femmes, en Suisse, le retour sur le marché du travail après une pause pour raisons familiales peut aussi être marqué par une certaine précarité.
Comment explique-t-on ce risque accru pour les seniors et les mamans?
Historiquement, la Suisse a connu, après la Seconde Guerre mondiale, comme tous les pays, un essor économique. Il n’y avait presque pas de chômage en Suisse jusque dans les années 1990. Le pays a connu une crise économique majeure dans les années 1992-1994, durant laquelle la société n’arrivait plus à reporter la précarité sur les migrants – on faisait peser sur eux l’injonction de rentrer «chez eux» – ou sur les femmes, dont on attendait qu’elles «restent à la maison». Cela a provoqué des changements de modèle. L’économie s’est mise à offrir des emplois différents de ceux proposés aux hommes des Trente Glorieuses: un travail standardisé de 9h à 17h à 100% pendant la semaine avec un contrat à durée indéterminée. Elle a aussi commencé à considérer que le coût du salaire des personnes plus âgées était un problème. En cause: des employeurs estimant que les travailleurs plus âgés étaient non seulement trop chers, mais qu’ils ne suivaient pas le développement technologique ou n’étaient plus assez innovants.
En Suisse, l’idée que les femmes font une pause professionnelle au moment d’avoir des enfants est assez largement ancrée. Le problème, c’est que cette pause de famille provoque une absence de suivi des développements dans leur profession qui rend la reprise difficile.
Cette évolution incessante des jobs, c’est nouveau?
Disons que les formations professionnelles doivent s’adapter à une situation où le parcours devient plus segmenté. Certaines formations procurent un savoir-faire plus généraliste, que l’on peut plus facilement transformer et donc aussi appliquer à plusieurs secteurs types de professions, tandis que d’autres sont plus spécifiques.
Si l’on prend l’exemple du déclin des ouvriers industriels classiques, en Suisse, on a assisté dans les années 1990 à des licenciements – de masse parfois – et les personnes concernées avaient de la peine à retrouver d’autres boulots parce que leur savoir-faire était très lié à leur ancienne entreprise, dont ils maîtrisaient les processus. Ils ne détenaient par contre pas forcément les clés pour valoriser leurs compétences auprès d’autres employeurs.
La formation continue serait-elle une solution?
Cela pourrait l’être, mais dans la réalité, elle n’est souvent réservée qu’à une catégorie de privilégiés au bénéfice d’une bonne formation initiale. Ils sont non seulement plus demandeurs, mais c’est aussi à eux que s’adresse une plus large offre de formations. Je dirais donc que la formation continue pourrait être un vecteur de changement. Or, dans la réalité, elle renforce plutôt les inégalités déjà existantes en matière de formation. Mais il y aurait bien sûr d’autres moyens de promouvoir davantage les groupes qui n’en bénéficient pas.
Les épisodes de précarité ne mettent-ils pas à mal le sens donné au travail?
Plusieurs études relèvent des effets de cicatrices: la majorité des gens qui traversent une phase de précarité en sortent, mais cela peut laisser des traces. Certaines personnes s’enferment dans une attitude où elles s’attendent à retomber dans ce type de situations. Elles perdent ainsi leur assurance sur le long terme et s’attendent à ce que cela se passe mal.
Est-ce aussi lié au changement de figure du patron?
Alors que l’entreprise était, dans les années 1960, une sorte de communauté avec ses avantages et ses inconvénients – comme un fort contrôle social –, en raison de la financiarisation et de la poursuite de la valeur actionnariale elle est devenue une « série de contrats » que l’on peut rompre et renouveler à volonté. Aujourd’hui, il est vrai que les entreprises ont beaucoup moins de scrupules à licencier. Mais ce n’est pas aussi radical en Suisse qu’aux Etats-Unis, par exemple. Notez que si l’on compare notre situation avec celle d’autres pays européens, la dévalorisation de la classe ouvrière en Suisse n’est pas aussi forte, par exemple, qu’en Allemagne, où l’économie mise sur du travail bon marché. Notre pays a su garder certaines protections. Il faut espérer que les luttes syndicales protégeront les personnes touchées par la précarité de l’emploi et que le système de formation donnera une chance aux jeunes, menacés par la précarité. Cette dernière, c’est sûr, a augmenté. Cela engendre une vraie souffrance. Mais, en même temps, à mes yeux, la tendance en Suisse ne s’aggrave pas de manière systématique et radicale. Il n’y a qu’à voir les réactions et les garde-fous mis en place contre les excès de l’économie de plateformes.