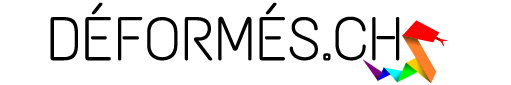Qu’est-ce qu’être riche?
Camions, sacs de courses ou chariots de supermarchés débordants, certificat d’études, télévision, permis de résidence… Ces objets miniatures accueillent les visiteurs à l’entrée de «Cargo Cults Unlimited», l’actuelle exposition du Musée d’ethnographie de Neuchâtel (voir le dossier).
Ils symbolisent la fête des Alasitas, en Bolivie, qui trouverait ses origines dans le calendrier agricole précolombien. Chaque année, durant trois semaines à compter du 24 janvier, les participant·es remercient Ekeko, divinité associée à l’opulence, puis acquièrent des mini-objets bénits – dans les églises par les prêtres catholiques, dans l’espace public par des yatiris, guides spirituels indigènes – pour leur conférer une «charge» afin qu’ils grandissent, et les offrent ensuite à leurs proches.
On se souhaite mutuellement la réussite, sans tabou ni fausse pudeur. Mais parmi les objets échangés, pas de super-yacht ni d’îles privées (à notre connaissance). «Les désirs exprimés sont ceux des classes sociales populaires et moyennes. La fête des Alasitas célèbre l’abondance ou l’opulence, le fait de ne pas manquer, d’être à l’aise, de pouvoir s’offrir des largesses. Il s’agit bien d’une forme de richesse, mais qui va bien au-delà de l’argent. La matérialité n’apparaît ici que comme l’une des formes de réussite: les titres de séjour, les diplômes montrent aussi une aspiration à une reconnaissance sociale. On est riche à travers le regard des autres», explique l’anthropologue Yann Laville, l’un des concepteurs de l’exposition.
La richesse constitue un phénomène éminemment social. Reste à en comprendre les dynamiques. En tant qu’humains, aspirons-nous profondément à accumuler des biens? Ou au contraire sommes-nous naturellement tournés vers la redistribution, le don? Les anthropologues ferraillent toujours sur le sujet et, pour résumer, les recherches tendent aujourd’hui à répondre «un peu des deux».
Ce qui est sûr, c’est qu’accumuler n’a pas pour but d’assurer une sécurité matérielle, mais va toujours de pair avec «la construction d’un statut social et d’une réputation», résume Yann Laville. Il y a donc du lien social dans la richesse. D’un autre côté, le don n’est jamais totalement désintéressé, comme l’explique Marcel Mauss dans son célèbre Essai sur le don (1925). Il souligne que celui-ci tient autant de l’obligation sociale que de l’élan naturel.
En Suisse, les actifs financiers constituent la richesse
La manière de vivre cette prospérité n’est pas univoque et se traduit très différemment selon la société et l’époque dans lesquelles on vit. En Suisse, à quoi ressemble la fortune aujourd’hui, de quoi est-elle constituée concrètement? «Ce sont les actifs financiers, actions et obligations qui constituent la richesse, et ce, depuis la fin du XIXe siècle», explique Matthieu Leimgruber, professeur d’histoire économique et sociale à l’Université de Zurich. Et de rappeler – petit moment de définition – que lorsque l’on parle de richesse, il faut «distinguer le terme du patrimoine que possèdent les classes moyennes. Etre millionnaire ne veut plus dire grand-chose, si l’on prend en compte les avoirs cumulés pour les caisses de pension. Le ticket d’entrée pour appartenir aux grandes fortunes démarre plutôt autour de 30 millions de francs». Une somme qui caractérise les ultra-HNWI (high-net-worth individuals, personnes au patrimoine ultra-élevé, dans le jargon financier). Le classement annuel du magazine Bilan des 300 plus riches de Suisse – dont la moitié sont en fait des étrangers domiciliés en Suisse pour des raisons fiscales – commence, lui, autour des 200 millions de francs. En 2020, on dénombrait environ 20'000 personnes déclarant au minimum 10 millions de francs (source: OFS).
Une capacité d’agir
Voilà pour les chiffres. Mais que signifie cette richesse, à quoi ouvre-t-elle? «En allemand, le patrimoine se dit ‹Vermögen›, ce qui contient le verbe ‹pouvoir› en français. Et cela traduit bien ce qu’est la richesse: une capacité d’agir», explique Matthieu Leimgruber. «Posséder un patrimoine de 250'000 francs, ce n’est évidemment pas rien. Mais être vraiment riche, c’est disposer de montants qui permettent d’agir sur la société, entrer dans un monde qui n’a plus rien à voir.» Le monde des élites internationalisées.
Un univers décrit de manière drôle et critique dans le pavillon suisse de la dernière Biennale d’art contemporain de Venise. L’artiste Guerreiro do Divino Amor y présente une vaste allégorie suisse moderne, Il miracolo di Helvetia, un monde de sérénité pour les puissants peuplé de déesses: Friedena pour la paix, Scopula, la perfection olympique, Calvina, la spiritualité, la morale et les mathématiques, Silentia, le silence… Un vrai paradis d’ultra-riches, pour qui argent rime avec pouvoir. Mais un univers paradoxal pour le spectateur, enviable pour sa beauté et son calme, voire hypnotisant, mais incongru à cause de sa superficialité, son clinquant, ses incohérences manifestes.
Richesse légitime
Ce lien entre pouvoir et richesse explique que la redistribution de l’argent a toujours été très scrutée. Encadrée socialement, même. «Au fil des siècles, une sorte d’équilibre délicat s’est noué, une série de structures sociales ont expliqué les seuils de richesse à atteindre, celles où il ne faut pas aller. Les religions, les systèmes philosophiques, politiques ont contribué à distinguer la richesse ‹légitime› de celle de l’ordre du péché, ont invité à éviter de consommer à outrance», résume Yann Laville.
Or ces équilibres évoluent. Aujourd’hui, les ultra riches sont-ils moins altruistes, plus portés sur une consommation ostentatoire qu’il y a deux siècles? Les fortunes suisses seraient-elles plus frugales qu’ailleurs, davantage portées sur la philanthropie? En l’absence d’étude sociologique détaillée sur ces univers très secrets, difficile de l’affirmer. Mais l’histoire apporte quelques réponses. «On a l’impression de richesses plus frugales en Suisse, mais ce n’est pas la réalité. Les patrons industriels de 1900 habitaient peut-être près des usines et étaient connus des ouvriers. Mais ils possédaient aussi des châteaux et des collections d’art», assure Matthieu Leimgruber. Enfin, comme dans tous les milieux, la richesse compte une sacrée diversité. «Un Hansjörg Wyss actif dans la politique scientifique ne redistribue pas son argent de la même manière qu’un Christoph Blocher, qui a investi sa personne et sa fortune dans un parti politique. Et ici, l’on ne parle que des personnes fortunées visibles. Une grande part reste dans l’ombre.»
Ce qui questionne aujourd’hui, c’est peut-être la concentration des richesses, qui paraît extraordinaire. Ici aussi, l’idée est à nuancer. «La richesse a toujours été très concentrée», explique Matthieu Leimgruber, qui étudie la constitution et la transmission des grandes fortunes en Suisse. «Depuis 1945, une classe moyenne patrimoniale s’est développée. Elle a pu accéder à la propriété de son logement et accumuler quelques avoirs financiers. Mais une telle déconcentration, très relative, de la richesse reste une situation atypique dans le temps long de l’Histoire.»
Une situation résultant de combats idéologiques qui ont fait évoluer nos représentations de la richesse. Dans ce domaine, la culture joue un rôle clé en matière de contestation ou de légitimation. Ainsi, les mouvements folk, reggae ou punk ont-ils décrié l’accumulation de richesses. Mais rien n’est gravé dans le marbre: «Tandis que le rap parodiait la richesse dans les années 1980 (grosses voitures, chaînes en or, villas), il en est devenu l’ambassadeur, observe Yann Laville. Aujourd’hui, certains rappeurs-entrepreneurs comptent leur fortune en milliards et font rêver un nombre incalculable de laissés-pour-compte.» Et le luxe constitue une culture en soi, presque une fuite au quotidien.