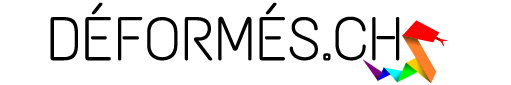« Les femmes sous-évaluent tout, y compris leur propre salaire »
Qui sont les femmes qui se tournent vers Softways ?
Aurore Bui : Nous travaillons avec des femmes migrantes qualifiées. Souvent, en raison des barrières à l’emploi, après deux ans en Suisse sans réussir à décrocher un poste, elles se tournent vers l’entrepreneuriat. C’est pour elles un plan B. Ce qui ne signifie pas qu’elles ne sont pas de « vraies entrepreneures ». Simplement, elles sont dépourvues des atouts classiques nécessaires à ce métier : un réseau et un certain niveau de confiance en elles.
Pourquoi la migration affecte-t-elle la confiance en soi ?
Ce sont des personnes qui ne sont pas reconnues. Les difficultés pour obtenir l’équivalence d’un diplôme provoquent une perte de confiance en soi. Une spirale négative se met alors en place. Et ces difficultés sont phénoménales pour des professions extrêmement qualifiées, par exemple avocat ou médecin. Parmi ces derniers, certains se sont retrouvés aides-soignants pour ne pas devoir refaire tout leur cursus de formation… De même, si on vous répète douze fois que votre profil n’est « pas adapté au poste », vous finissez par douter de vous. D’une manière générale, la migration est un moment de rupture : on quitte un confort, on se retrouve sans terreau familial, face à la solitude, contrainte d’apprendre les codes d’une autre culture.
Pourquoi miser sur la solution de l’entrepreneuriat ?
Il y a, d’abord, un argument économique : avec ces blocages, notre économie perd des talents. Il faut donc les solliciter là où ils se trouvent. Sur le plan financier, pour ces femmes, attendre un processus de reconnaissance de diplôme, qui peut facilement prendre deux ans, implique non seulement un « vide » dans le CV, mais également un manque de cotisation du second pilier. Par ailleurs, l’entrepreneuriat favorise l’échange d’idées et la confiance en soi. Ainsi, l’association Amala a lancé, à Genève, un service traiteur multiethnique qui permet à différentes femmes de valoriser leur savoir-faire (préparer la cuisine de leur pays), nouer des contacts, travailler à temps partiel…
Pourquoi aider spécifiquement les femmes migrantes, et non les hommes ?
Pour être entrepreneur, il faut une dose de folie et d’ego, savoir se donner à 150 %… c’est une machine à burn-out. Nous accompagnons aussi bien les migrantes et les femmes suisses et nous constatons qu’elles connaissent la même difficulté à entrer dans cette posture. Par exemple, elles ne demandent pas ou peu d’argent pour lancer leur entreprise. Si elles sollicitent un financement, elles demanderont 80 % de ce qui est nécessaire. La moyenne des sommes demandés par les femmes qui lancent leur entreprise à Genève est de 60 000 francs, pour les hommes, c’est 80 000. Les femmes sous-évaluent tout, y compris leur propre salaire. La migration exacerbe encore ces blocages. De l’autre côté, les personnes qui attribuent les financements sont encore souvent des hommes blancs de 60 ans, qui, même inconsciemment, ne s’identifient pas de la même manière à un jeune homme de trente ans et une femme du même âge, même s’ils portent le même projet.
Face à ces barrières, quelles aides spécifiques sont nécessaires pour les femmes que vous accompagnez ?
Les femmes sont surreprésentées dans la catégorie des très petites entreprises. Peu de leurs projets grandissent ou changent d’échelle, car cela implique de déléguer. Nos programmes prévoient du coaching et de l’aide pour trouver du financement (ce qui ne résout pas les problèmes de biais). Nous avons mis en place un système de mentorat par une femme entrepreneure expérimentée.
D’autres freins fréquents sont liés à la parentalité. Parfois, le réflexe est de se dire « je ne trouve pas d’emploi, c’est peut-être le bon moment pour faire un enfant ». En soi, cela ne pose pas de problème, mais dans une situation de migration, un congé maternité, ajouté à la gestion d’enfants en bas âge et à une couleur de peau ou à un nom différent peuvent malheureusement entraîner un arrêt professionnel de quatre ou cinq ans. Et à partir de là, il devient difficile de retrouver un emploi dans le secteur dans lequel on est pleinement qualifié. Le raisonnement de certains acteurs économiques est de recruter ces personnes-là sur des postes moins qualifiés, par exemple choisir une ingénieure comme assistante de direction, au motif que « ce sont des compétences pas chères ». Pour moi, c’est un raisonnement faux et court-termiste : sur le long terme, notre pays ne bénéficie pas pleinement de la valeur de la personne.
L’OCDE, dans un rapport de 2012, signale que la Suisse est en retard dans la lutte contre les discriminations dans le monde professionnel. Est-ce ce que vous observez ?
Oui, on observe des biais à l’embauche du fait d’avoir des enfants, de la couleur de peau, des arrêts professionnels, d’un parcours atypique… Étonnamment, on constate dans l’entrepreneuriat social que les femmes dirigeantes corrigent ces biais, parfois inconsciemment. Par exemple, une femme entrepreneure mère célibataire de quatre enfants avait embauché dans son entreprise trente femmes… toutes célibataires avec enfants. Ce biais était involontaire, j’en ai discuté avec elle, mais il correspondait à son vécu ! Elle a fait de « la responsabilité sociale » sans s’en rendre compte…
L’entrepreneuriat social est-il un secteur qui fait fondamentalement bouger les lignes ?
Je suis persuadée que c’est un mouvement qui prend une ampleur énorme. Il concentre une grande proportion de femmes, pour qui un changement de paradigme est en train de se produire aujourd’hui. Le point commun entre tous les profils d’entrepreneures que nous accompagnons est la notion de résilience : vouloir « sortir des rails » et faire quelque chose qui fait sens, parce que la migration a entraîné une rupture dans l’existence.
Cela crée des entreprises plus humaines, mais aussi des emplois différents, avec une valeur sociétale permettant la réinsertion et ouvrant à la collaboration. Ce sont des modèles encore peu répandus. Je crois que c’est important d’en avoir à l’esprit et autour de nous.