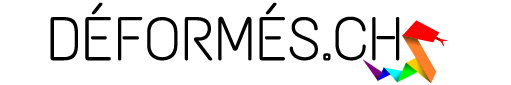Ni victimes ni complices, «juste fatigué·e·s»
«Chaque année, c’est pire!» Elle ponctue sa phrase d’un petit rire, mais le quotidien de Miriam Amrani, thérapeute indépendante et musulmane à Fribourg, n’a rien de drôle. Il est ponctué d’attaques, larvées. Des «regards lourds», des remarques ou gestes blessants… Comme ce passant qui lui fait signe de tomber son foulard, le lendemain d’une votation sur la burqa. Elle lui répond par un sourire. Mais cette quinquagénaire se dit «fatiguée» de ces micro-agressions. D’autant plus qu’elle préside une association qu’elle définit comme «facilitatrice d’intégration», Espace Mouslima, offrant de la médiation dans les écoles, des rencontres entre femmes de quatorze nationalités… Ces remarques ont eu raison de la légèreté dans son quotidien. Les lendemains d’attentats, «si je peux, je ne sors plus», affirme-t-elle.
A 23 ans, Zahra Ali, à Fribourg, a constaté le lien entre la survenue d’attentats et les insultes en raison de sa religion. «J’ai senti la haine venir même de voisins, qui m’ont pourtant vue grandir ici!» Elle a opté pour la stratégie inverse: «Au début, je ne disais rien. Et puis, vers 18-19 ans, j’ai compris que l’attente des agresseur·e·s était précisément que je subisse en silence. Alors, j’ai décidé de répondre, dénoncer, Ni victimes ni complices, «juste fatigué·e·s» porter plainte. Même si la justice peut décevoir…» Le réseau des jeunes musulmans de Suisse a organisé de nombreux ateliers, ces dernières années, pour affronter les conflits et les clichés, par exemple au travail. «Une personne musulmane en Suisse doit être proactive, comprendre ce qui se joue quand quelqu’un soulève un débat, problématiser les préjugés, y compris lorsqu’ils viennent d’autres musulmans», assure Ebnomer Taha, son président de 32 ans.
Tracasseries
Si des statistiques sont difficiles à établir sur une décennie, ces actes d’inimitié sont néanmoins en hausse. La Commission fédérale contre le racisme les qualifie «d’hostilité envers les musulmans» plutôt que d’«islamophobie», terme qui met l’accent sur «le rejet émotionnel de l’islam en tant que religion». Elle leur a consacré un colloque en 2017. Une question clé est ressortie de cette journée: «Notre perception et nos relations avec les musulmans ne sont-elles pas avant tout l'expression de notre propre incertitude vis-à-vis des traditions culturelles et religieuses occidentales face à la mondialisation, au consumérisme, au libéralisme?»
Cette hostilité qui a mille visages concerne aussi des communautés. «Les tracasseries pour louer des biens sont de plus en plus fréquentes. Les régies ne donnent pas facilement des lieux à louer à des organisations musulmanes. Et parfois, ce sont les banques qui se rétractent au dernier moment pour l’octroi d’un prêt, bien que les fonds propres proviennent entièrement de Suisse», témoigne Montassar BenMrad, président de la Fédération des organisations islamiques de Suisse. Ces obstacles structurels, couplés à la demande permanente de se désolidariser après chaque attentat, finissent par épuiser, voire diviser les fidèles.
Farah Hocine a 27 ans: elle avait sept ans lorsque les tours jumelles se sont effondrées. Après une scolarité à Berne, dans une école internationale et ouverte, c’est en entrant au gymnase à Bienne qu’elle se retrouve réduite à sa religion par des élèves encore peu confrontés à la diversité. «J’avais l’impression de devoir me justifier et m’expliquer en permanence. J’étais interrogée tout le temps. C’était insupportable! Oui, je ne bois pas d’alcool, mais on ne devrait pas me demander pourquoi…»
Pourtant, Farah Hocine adore expliquer: elle est notamment guide pour Dialogue en route, programme qui permet de visiter des lieux de culte. «J’ai étudié l’histoire des religions, un domaine que j’adore, car il permet de comprendre les fondements de notre société.» Mais expliquer les fondements d’une religion n’est pas devoir justifier ses choix personnels, «comme si sa religion était une anomalie ou une phase. A force, je dois reconnaître que cela donne envie de rester entre soi. Si je dois choisir une amie ou un compagnon, je préfère quelqu’un qui comprend, qui connaît mon vécu». Pour éviter que son identité lui soit «renvoyée à la figure» dans les interactions quotidiennes, Farah Hocine en vient même à «essayer de ne pas trop dire» qu’elle est musulmane.
Discrétion
Faire profil bas. C’est aussi l’attitude du soufi Philippe Mottet. «Des fois, quand les gens découvrent que je suis musulman, ils croient que je blague», s’amuse le président de l’Association internationale soufie Alâwiyya (AISA) Suisse. Sa communauté ne publie plus de communiqué pour dénoncer les attentats de djihadistes. Une discrétion qui s’explique par le fait qu’à l’étranger les soufi·e·s sont régulièrement victimes des terroristes. «Communiquer servirait juste à désigner de nouvelles cibles.» Cette prudence n’empêche pas l’engagement sociétal: pour dépasser les antagonismes construits à la suite du 11 septembre 2001, AISA ONG internationale a fondé, en 2017, une journée internationale «du vivre-ensemble en paix», soutenue par l’ONU.
Faut-il en arriver à gommer son identité pour vivre sa religion? A Genève, le musulman chiite d’origine iranienne Vahid Khoshideh, président de l’Association islamique et culturelle d’Ahl-el-Bayt, s’est retrouvé confronté à la question. Cet homme qui a beaucoup cheminé se définit comme libéral, «cherchant à mettre en avant la part spirituelle du Coran, plutôt que des règles à suivre à la lettre». Il y a dix ans, sa mosquée est exclue sans explication d’une association de quartier, après une fête commune, qui s’est pourtant déroulée sans encombre. «On a senti qu’afficher notre culture islamique dérangeait. Mais pour nous, c’est une question d’identité. On s’est interrogés: on ne va quand même pas s’appeler association pour la paix? On veut que les gens sachent que nous sommes là, musulmans, et humains comme les autres, avec nos croyances et la volonté de vivre en harmonie!»
Pour Pascal Gemperli, secrétaire général de l’Union vaudoise des associations musulmanes (UVAM), qui a affaire depuis douze ans avec la société civile, ces raccourcis fréquents entre islam et terrorisme viennent d’un manque de connaissances. «Quand des comportements problématiques surviennent dans des communautés chrétiennes, les gens en Suisse savent les lire, à quel courant minoritaire ou quelle pensée spécifique les rattacher. Mais pour l’islam, la moindre information négative, issue parfois de groupes ultra-minoritaires, est associée aux musulmans dans leur ensemble.»
Guerre culturelle
Le manque de connaissances, admet Pascal Gemperli, en vient à concerner… les musulman·e·s mêmes. «Si les amalgames entre islam et terrorisme sont véhiculés par les médias, le risque, c’est vrai, c’est que certains de nos jeunes y adhèrent.» Et de souligner la difficulté qu’ont les communautés, «déjà à la limite en matière de ressources humaines», pour contrer les discours extrémistes circulant sur le web. «On s’oppose à ces visions de manière claire et répétée. Mais si, dans le discours public ici, l’islam est associé à la violence, on peut dire qu’en matière de guerre culturelle et terminologique, les terroristes ont gagné. Face à ça, on est déçus et en colère. A vrai dire, quand des personnes reprennent à leur compte cette compréhension dévoyée de l’islam… on ne sait plus quoi faire.»
Dépasser la victimisation
L’impuissance a aussi failli avoir raison de la détermination de Dia Khaddam. A Genève, cette maîtresse d’arabe a participé à de multiples actions de dialogue. «Mon but, c’est toujours de faire le pont entre deux manières de penser, celle des musulman·e·s et celle d’une société différente, mais qui a énormément de richesses à m’offrir, et qui est ouverte d’esprit à la base.» Le lendemain du 11 Septembre, elle a vu apparaître «des regards remplis de haine et de suspicion». Dia Khaddam est passée par «la colère, la honte, l’humiliation d’être associée à l’‹axe du mal›». Elle a connu ensuite la frustration de voir ses efforts de rapprochement détruits par un nouvel attentat. Cette maman de neuf enfants a senti les difficultés survenir dans la vie scolaire. Au sein de communautés musulmanes, elle a vu aussi diverses idéologies gagner du terrain. Pourtant, affirme-t-elle, «en vingt ans, je ne me suis jamais dit que cela ne valait pas la peine. Notre rôle comme connaisseurs de l’islam, c’est de faciliter sa compréhension. Et en tant que parents, c’est d’éviter de transmettre à nos enfants la colère que nous pouvons avoir face à des injustices. Quelles seront nos empreintes, ici, comme musulmans? Qu’avons-nous fait pour être compris du reste de la société? Je crois qu’il faut dépasser la victimisation. Et sans cesse planter la graine de la patience face à tous les préjugés.»