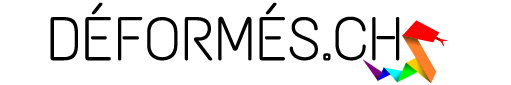Pourquoi la Suisse n’a toujours pas digéré le rapport Bergier
C’est une recherche que peu ont pu lire mais qui fait déjà couler beaucoup d’encre. L’historienne Ruth Fivaz-Silbermann a défendu avec succès à l’Université de Genève sa thèse de doctorat intitulée «La fuite en Suisse. Migrations, stratégies, fuite, accueil, refoulement et destin des réfugiés juifs de France durant la Seconde Guerre mondiale». La chercheuse y retrace le parcours de réfugiés juifs qui se sont présentés à la frontière suisse à partir de l’été 1942: «C’est le moment où les Juifs vivants ou réfugiés en France, en Belgique ou en Hollande commencent à être déportés et exterminés systématiquement. C’est aussi le moment où la Suisse cherche à fermer complètement ses frontières». A partir du mois de novembre 1942, les Allemands occupent la Zone libre auparavant placée sous le gouvernement de Vichy. La Suisse est alors complètement entourée par les puissances de l’Axe et doit gérer l’arrivée de réfugiés à ses frontières. Certains sont refoulés. D’autres non. Selon la chercheuse, un peu moins de 3’000 personnes juives se sont vues interdire l’entrée sur le territoire helvétique à la frontière franco-suisse entre 1942 et 1945, où sont passés les deux-tiers des réfugiés. D’après le rapport Bergier publié en 2002, plus de 20’000 personnes (juives et non juives) ont été refoulées le long de toute la frontière suisse, de 1939 à 1945. Le débat est ouvert.
Si la tension est palpable autour de la thèse de Ruth Fivaz-Silbermann, c’est peut-être aussi parce qu’il y a la crainte que la controverse puisse alimenter une vision révisionniste autour de ce moment de l’histoire suisse. L’historienne s’en défend. Le controverse sur le nombre de Juifs interdits d’entrée aux frontières et l’attitude paradoxale de la Suisse au cours du conflit n’exonère pas les autorités du pays d’une faute morale: «Je ne prétends surtout pas réhabiliter l’image romantique d’une Suisse qui aurait fait tout juste pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est clair que la Confédération a refusé l’entrée sur son territoire à des gens pour qui le fait de passer la frontière était une question de vie ou de mort. Qui plus est, la question de ces chiffres n’occupe que 30 pages de ma thèse qui en compte 983.»
Une querelle de chiffres
L’historien Marc Perrenoud, ancien membre de la Commission, admet que la question est difficile à trancher: «Les documents dont nous disposons sont trop lacunaires pour nous permettre d’articuler un chiffre exhaustif». Comme de nombreux historiens, le chercheur rappelle que ces statistiques peuvent comprendre des personnes qui ont été refoulées à plusieurs reprises et pour des motifs différents du fait d’être juif. Il mentionne les autres recherches menées sur le sujet: «Le premier rapport sur la question a été publié en 1957 par le juriste Carl Ludwig sur mandat de la Confédération. Il estimait alors le nombre de candidats au refuge refoulés à la frontière à 10’000 personnes». Mais le registre que le juriste avait pu consulter pour effectuer son estimation a aujourd’hui disparu, sans que personne n’ait d’explications. Bien plus tard, c’est l’historien Guido Koller, responsable des archives fédérales, qui articule le chiffre de 25’000 refoulements, revu un peu à la baisse dans le rapport Bergier final. «Ces différentes estimations ne tiennent évidemment pas compte des personnes sur qui la politique restrictive de la Suisse a eu des effets dissuasifs», analyse encore Marc Perrenoud.
L'affaire des fonds en déshérence
Pour comprendre cet état de fait, il faut remonter en mai 1995. Kaspar Villiger alors président de la Confédération prononce un discours devant l’Assemblée fédérale dans lequel il présente les excuses de la Suisse concernant l’imposition du tampon «J» sur les passeports des Juifs allemands à partir de 1938. Cette même année, la Suisse est alors frappée par l’affaire des fonds en déshérence: l’argent de familles juives placé auprès de banques suisses n’a pas été rendu aux survivants de la Shoah ou à leurs descendants. Un an plus tard, le Conseil fédéral mandate le groupe d’experts dirigés par Jean-François Bergier afin de faire la lumière sur le problème et d’explorer plus en détail les relations que la Confédération helvétique a entretenues avec le régime nazi. La Commission Bergier rend public son rapport cinq ans plus tard. Le contexte a alors changé. L’affaire des fonds en déshérence a fait l’objet d’une négociation: en 1998, les banques suisses se sont engagées à verser près de 1, 25 milliards de dollars aux organismes chargés d’indemniser les personnes concernées. Bref, tout le monde semble vouloir tourner la page au moment où le rapport de la Commission est rendu public en 2002.
Marc Perrenoud regrette l’absence d’un grand débat suite au dépôt des recherches de la Commission et déplore la succession de polémiques visant surtout à dénier le caractère sérieux et scientifique des études menées par les experts : «Les parlementaires n’ont même pas souhaité aborder le résultat des recherches en plenum, au Parlement fédéral».
Comparé à d’autres pays, la Suisse n’a pas vraiment de compétence mémorielle, analyse de son côté Ruth Fivaz-Silbermann : «Elle vit dans le mythe de son existence et écrit son histoire en noir et blanc alors qu’il y aurait tout une palette de gris à utiliser. Jusqu’au rapport Bergier, ce qui a essentiellement prévalu auprès de la population, c’est l’image très positive d’un petit pays qui aurait su défendre sa tradition humanitaire». Pour sortir de l’impasse, au delà des querelles et des controverses entre historiens, il convient d’entretenir l’héritage des recherches effectuées jusqu’à présent. Pour Marc Perrenoud, le Rapport Bergier reste un très bon outil qui montre la complexité des problèmes, qui livre des analyses nuancées et novatrices. Néanmoins, il est fustigé par des gens qui souvent n’ont même pas ouvert un des nombreux volumes de la recherche: «Il y a encore des efforts importants à produire en matière de diffusion pour faciliter son accompagnement auprès des jeunes générations. Il y a toujours un énorme fossé entre les résultats des analyses historiques et leur intégration dans l’enseignement».
Heinrich Rothmund, une figure controversée
Au débat concernant le nombre de réfugiés refoulés s’ajoute encore la question de savoir si les autorités helvétiques savaient ce qui se passait en Europe de l’Est lorsqu’elles ont décrété, en été 1942, qu’il ne fallait en principe pas laissé entrer les personnes ayant fui en raison de leur «race». «Dès la fin de 1941, des informations faisant état de massacres systématiques sont parvenues en Suisse par différents canaux», peut-on lire dans le Rapport final. A l’époque, un personnage clef de cette politique de fermeture des frontières est Heinrich Rothmund, directeur de la division de police au Département de Justice et Police. Il est chargé de veiller à l’application de la politique de fermeture décidée par le Conseil fédéral. Xénophobe, antisémite, Rothmund est le bouc-émissaire parfait d’une Suisse qui veut cultiver la mémoire de sa tradition humanitaire tout en reconnaissant quelques débordements.
«J’ai essayé de faire comprendre à ces messieurs (les responsables allemands) qu’en Suisse nous avons reconnu dès le début le danger de l’ ‘enjuivement' (Verjedung, en allemand)», écrit-il dans un rapport destiné au Conseil fédéral en 1942. Difficile d’ignorer que Rothmund faisait preuve d’un antisémitisme primaire, tout particulièrement quand il était question de Juifs étrangers : «Le fait que nous ne nous laissions pas mener par le bout du nez, et surtout pas par les Juifs de l’Est -connus pour revenir sans cesse à la charge parce qu’ils ont de la peine à aller droit au but- devrait coïncider avec les vues du peuple suisse», écrit-il au conseiller aux Etats Ernst Löpfe Benz peu avant le début du conflit. «De telles déclarations n’émanaient pas seulement de Rothmund, mais s’inscrivaient dans le contexte global de la politique à l’égard des réfugiés», analysent encore les auteurs du rapport Bergier.
«Rothmund est certainement xénophobe mais il n’est pas antisémite au sens où le sont les nazis», affirme de son côté Ruth Fivaz-Silbermann. L’historienne, rappelle que l’ancien directeur de la police n’a jamais répondu favorablement aux demandes de visa mais a par contre systématiquement tranché en faveur des réfugiés menacés de renvoi quand leurs dossiers parvenaient jusqu'à son bureau. Cette attitude est emblématique des dispositions que la Suisse prend à l’égard des réfugiés: «J’y vois deux politiques parallèles qui coexistent de manière presque schizophrène: d’un côté, on développe un discours qui soutient une position extrêmement restrictive en insistant sur le fait que les personnes ne sont pas les bienvenues et sont sujettes à des refoulements, mais dans le même temps, on développe un certain pragmatisme quand il s’agit de gérer les cas aux frontières. Cela permettait à de nombreuses personnes menacées d’entrer tout en gardant la frontière fermée». Pour Ruth Fivaz-Silbermann, le directeur de la police a en fait infléchi ses positions sur l’accueil des réfugiés au cours du conflit: «Le Rothmund de 1942 n’est plus le Rothmund de 1938. Au mois d’août 1942, il se rend sur la frontière pour observer ce qui s’y passe. Il se retrouve confronté à une famille juive qui est partie de Bruxelles. Les garde-frontières s’apprêtent à les refouler. Il s’y oppose.»