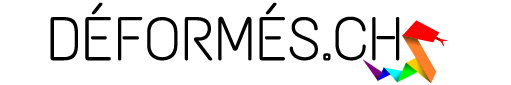«On n’écartera jamais un sujet sous prétexte qu'il n’est pas a priori assez profond»
Comment définiriez-vous le roman graphique?
François Le Bescond: En premier lieu, ce n’est pas un genre car un roman graphique peut tout simplement être une adaptation littéraire, une biographie, un polar, une enquête, etc, mais plutôt quelque chose qui se définit par sa forme. Concrètement c’est un album qui a une forte pagination, au moins cent pages, les formats sont généralement plus petits que les standards de la bande dessinée avec une approche graphique simplifiée et un traitement un peu plus «littéraire». Le noir et blanc est plus fréquent, les couleurs sont souvent moins présentes que dans un album traditionnel. On considère que le roman graphique est réellement apparu avec Will Eisner (1917-2005), maître de la BD américaine, en 1978 avec l’album A contract with God, dans sa manière de traiter l’histoire, dans sa forme et le fond. D’autres ont suivi, dont Art Spiegelmann avec le célèbre Maus (1980-1991). Chez Dargaud, dans les années 90, nous avions édité une collection intitulée «Roman BD» (dans laquelle on trouvait des auteurs tels que Sfar, Autheman, Cailleaux, David B, Montellier, etc), peut-être un peu tôt car à l’époque les librairies et les lecteurs n’avaient pas l’habitude de ce format. La collection a été interrompue mais elle a posé des jalons.
Pourquoi le roman graphique a depuis trouvé son public?
La BD a su s’ouvrir à travers les sujets qu’elle aborde. Pendant longtemps le médium était dominé par les séries, aujourd’hui, c’est moins le cas, elles existent toujours mais les auteurs sont à même de s’intéresser à des tas de sujets (de société, de savoir, de politique, des biographies, des documentaires…) qui n’étaient pas toujours traités dans le cadre de séries classiques. Dargaud a ainsi sorti Cigarette, le dossier sans filtre, de Stéphane Brangier et Pierre Boisserie (2019) sous forme d’une enquête avec une approche quasi-journalistique, c’est assez nouveau, cela ne se faisait que rarement auparavant. La BD a su aussi créer des passerelles, il y a une ouverture d’esprit de la part des lecteurs qui sont par exemple capables de s’intéresser au roman de la Princesse de Clèves mais aussi à son adaptation en bande dessinée (par Catel et Claire Bouilhac, 2019).
Justement, quel lectorat lit le roman graphique, n’est-il pas avant tout un produit pour un public aisé?
Ce n’est ni tout à fait vrai ni complètement faux. Les fortes paginations augmentent mécaniquement le prix moyen du livre et les lecteurs qui ont un pouvoir d’achat conséquent sont nécessairement moins touchés. C’est d’autant plus vrai que les thématiques abordées dans les romans graphiques, que l’on trouve plus facilement chez des libraires généralistes, intéressent plus particulièrement ces personnes, par opposition aux grandes séries traditionnelles, plus «accessibles» et parfois diffusées en grandes surfaces. Certains romans graphiques ont cependant obtenu un vrai succès populaire, je pense par exemple à S’enfuir, récit d’un otage (Dargaud, 2016) par Guy Delisle, d’après l’histoire vraie d’une personne prise en otage en Tchétchénie. Ce titre a dépassé les 60 000 ventes et a été traduit dans de nombreux pays! Le roman graphique peut donc toucher un public large, même s’il s’adresse un peu plus souvent aux fameux «CSP+».
Est-ce que les nouveaux outils techniques utilisés par les auteurs jouent un rôle dans la profusion de romans graphiques disponibles?
Je ne vois pas de lien direct. Sans doute que les tablettes permettant de travailler numériquement facilitent le travail, mais certains auteurs qui se sont testés à cette technique retournent au papier, car cela représente pour eux le même temps de travail et ils ont souvent besoin d’avoir cette sensation que permet l’outil traditionnel, le papier. La plupart du temps les auteurs travaillent chez eux ou en atelier. Les tablettes de type Ipad Pro permettent de travailler de façon nomade, ce qui permet par exemple de travailler en voyageant, notamment dans le cas de reportage ou repérage, c’est ici un gain de temps surtout si l’auteur simplifie son dessin en vue d’un roman graphique. Mais on trouve toujours un contre-exemple: la récente biographie Orwell par Pierre Christin et Sébastien Verdier (Dargaud, 2019) a nécessité cinq ans de travail au dessinateur avec un dessin ultra-détaillé!
Est-ce que la féminisation de la profession joue aussi dans l’émergence de nouveaux thèmes?
Incontestablement, oui. Il existe de plus en plus d’autrices qui apportent un regard différent, qui enrichissent ce médium. Alice Chemama et Méliane Marcaggi consacrent par exemple un roman graphique sur Emile Zola (Les Zola, Dargaud, 2019) en s’intéressant d’abord aux deux femmes qui ont partagé la vie de l’écrivain, c’est un vrai point de vue. Pendant longtemps la BD était un médium essentiellement masculin par ses auteurs mais aussi ses lecteurs! La «féminisation» s’est vraiment accélérée ces dernières années: Catherine Meurisse, Catel Müller, Claire Bouilhac, Aimée de Jongh, Léa Mazé, Ingrid Chabbert, Sandrine Revel, Julie Birmant, Eve Tharlet, Brigitte Luciani, Vanyda, Julie Rocheleau ou Florence Dupré-Latour sont parmi quelques-unes des autrices avec qui l’on travaille. Elles ont chacune leur personnalité et abordent certains thèmes pas toujours évidents à traiter. Dans Idéal Standard, (Dargaud, 2017) Aude Picault décrypte le quotidien d’un couple, sujet a priori rebattu, avec beaucoup d’intelligence et un sens aigu de l’observation proche de celui de Claire Bretécher ou Florence Cestac, deux grandes dames de la bande dessinée.
Existe-t-il davantage de place aujourd’hui pour l’intériorité, les cheminements?
Comme les romans graphiques permettent de traiter certains sujets sur plus de pages, un auteur a plus de facilité et de latitude pour développer des émotions, des questionnements existentiels, des trajectoires de vie. Sur 48 pages, c’est plus compliqué, on ne peut pas vraiment développer ces aspects-là car la place manque, tout simplement. Un exemple intéressant: durant les 432 pages de S’enfuir, Guy Delisle revient sur tout ce que peut ressentir un otage, à quoi on s’accroche pour tenir le coup, le sens de la vie, la résilience… Le tout avec une unité de lieu imposée par la captivité. C’est un tour de force magistral de la part de l’auteur !
Qu’est-ce qui fait une biographie réussie à l’heure où le biopic est devenu un phénomène de mode?
C’est le point de vue de l’auteur qui nous intéresse. Souvent il ne choisit pas de raconter toute une vie mais se concentre sur un moment-clé. Dans Sartre (Dargaud, 2015), Anaïs Depommier et Mathilde Ramadier se concentrent sur la vie du philosophe entre le moment où il sort de l’Ecole nationale supérieure et celui où il refuse le Prix Nobel de littérature, ce qui permettait aussi de s’attarder sur sa relation fusionnelle avec Simone de Beauvoir.
La bande dessinée c’est avant tout une histoire et le point de vue de l’auteur sur cette histoire. Parfois une histoire a priori insignifiante peut s’avérer passionnante si la façon qu’aura l’auteur de raconter son histoire est originale. On n’écartera jamais un sujet car il n’est pas a priori assez profond. Dans Les grands espaces (Dargaud, 2018), Catherine Meurisse (survivante du massacre de Charlie Hebdo en 2015, ndlr) livre une autobiographie qui fait partie d’une reconstruction plus personnelle après la tragédie de Charlie. Elle se met en scène, jeune, et aborde des souvenirs heureux, à la campagne. Elle rappelle l’importance de la transmission par ses parents, une forme de tolérance que lui a apporté son éducation, une ouverture d’esprit, l’éveil à la nature et la culture dont la peinture qui sera fondamentale pour elle. C’est un ouvrage très fort et positif, touchant et subtil sur un sujet qui aurait pu être anecdotique: l’histoire d’une jeune femme à la campagne.
Quels sont le-les romans graphiques qui, pour vous, utilisent au mieux le potentiel sur le fond et la forme pour évoquer des questions profondes?
C’est évidemment réducteur de n’en citer que certains. Spontanément, je pense à Trap (Dargaud, 2019) où Mathieu Burniat et Michiels Loup racontent le parcours d’un homme qui doit chasser - à une époque indéfinie dans une nature hostile – et capable de prendre le pouvoir des animaux en revêtant leur peau… avant de se retrouver lui-même traqué par un prédateur! C’est humoristique, tragique, décalé, fantastique et les auteurs ne font pas appel au texte mais uniquement à l’image. Même chose avec Sabre (Dargaud, 2019) où Eric Feres, dont c’est le premier album, décrit sans aucun dialogue la vie d’un petit tigre qui a l’air fragile et différent du reste de la meute, à l’époque préhistorique. C’est une métaphore sur la difficulté d’exister et la survie en milieu hostile alors qu’on ne semble pas armé pour pouvoir affronter ces épreuves. Dans les deux cas nous avons été assez bluffés par la façon d’utiliser les possibilités narratives de la BD où il n’est pas toujours utile de passer par le texte pour raconter une histoire. L’image permet de suggérer des sentiments, des émotions et de faire comprendre des choses indicibles.