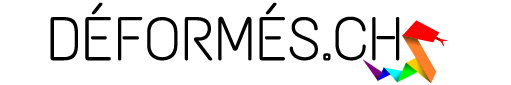«On n’éduque plus ses aînés»
«L’autre jour, elle m’a encore fait venir en urgence!» Elisabeth, appelons-la ainsi, tire une longue bouffée sur sa cigarette, un sourcil relevé, exaspérée. A 63 ans, cette Valaisane installée à Genève a élevé cinq enfants, quitté son époux, et imaginait une retraite tranquille: vadrouilles entre copines, visites à ses petits-enfants, à sa maman. Mais cette dernière, plus très autonome, la sollicite systématiquement pour des urgences. «Entre elle et moi, ce n’est jamais passé: je n’étais pas celle qu’elle voulait. Mais au sein de la fratrie je suis la plus proche géographiquement. Et en cas de pépin, elle intime qu’on soit là de suite. Devoir lui dire non engendre des remords, alors que les choses pourraient être plus douces. Cette relation provoque de la colère et de l’impuissance…»
Moments de grâce et ras-le-bol
A Neuchâtel, Lydia, également un prénom d’emprunt, est «bonne élève». Cette jeune séniore travaille toujours, mais se rend au chevet de ses parents nonagénaires sept jours par mois. Toilettes, repas, courses: tout, y compris les tâches les plus ingrates. «Je ne perds pas mon temps, je le consacre!» souligne-t-elle. Pour autant, la situation reste pénible pour elle. Il y a d’abord la confrontation, inéluctable, avec une forme de déchéance physique. «C’est désagréable: j’ai sous les yeux ce que je vais devenir! En ce sens, voir le corps de ma mère m’est plus pénible que celui de mon père. C’est un miroir implacable, comme si j’étais déjà cette enveloppe charnelle qui se défait. Cela m’empêche d’imaginer une autre vieillesse!»
Et puis un profond «ras-le-bol» qui surgit d’une «impuissance complète», face à cette situation qui s’éternise, mine de rien. «Ils n’y peuvent rien, ce ne sont pas des acharnés à vivre qui enchaînent opérations sur interventions! Je vois bien qu’ils sont fatigués eux aussi. Je ne peux pas leur en vouloir!» Les jours où elle est pressée ou stressée, le spectre de la maltraitance verbale n’est pas loin… Tout n’est, bien sûr, pas si noir: Lydia décrit aussi des moments de grâce absolue devant son papa qui n’a plus toute sa tête et dont les mots composent une poésie magnifique. Ou son admiration pour une maman souffrante, «déterminée à rester coquette jusqu’au bout».
Reste qu’au quotidien rien n’est simple, surtout quand les relations familiales n’ont jamais été au beau fixe. «Mes parents ne sont pas d’une génération où on se remet en question. Et puis on ne les éduque pas!» Quant au sens de tout cela, Lydia n’est pas très sûre de le trouver. «Bien sûr, ‹tactiquement›, au moment du deuil, je pourrai me dire que j’ai fait tout ce qu’il fallait… Mais quand ce grand vide sera là, cela va-t-il seulement me servir?»
Pouvoir investir le relationnel
Comme Lydia et Elisabeth, l’immense majorité des proches aidantes en Suisse romande sont des femmes. Et leurs difficultés ont longtemps constitué «un impensé social», selon Blaise Willa, rédacteur en chef du mensuel romand Générations plus, qui a consacré en janvier 2023 un dossier aux «vies très longues»*. «Cette génération a vu son espérance de vie bondir, comme les autres. Mais qui s’en occupe? A cet âge, la qualité de vie est centrale, mais la question de la dépendance aussi. Nous n’avons pas encore pleinement intégré ces défis dans notre système de santé, nos institutions, nos assurances sociales…»
«La question des proches aidantes n’est pas un impensé social», nuance Valérie Hugentobler, professeure et co-doyenne du Laboratoire de recherche santé-social (LaReSS) de la haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL). «Depuis quelques années, elles sont devenues une catégorisation d’action publique. On a vu émerger des conseils, des consultations spécialisées, des services de relais, des plateformes pour coordonner et rendre plus visible ce qui existe pour ces personnes. Une attention particulière est accordée aux enjeux de conciliation entre vie professionnelle et soutien à des proches, car le marché du travail et le maintien des proches aidantes en emploi sont des enjeux importants face à une population active qui vieillit.»
Loyauté et assignation
Mais, concède la chercheuse, il est vrai que, pour ces femmes séniores pourvoyeuses de «care», la prise de conscience des impacts de ce travail sur leur propre santé physique et psychique reste faible. Certes, pour leurs aînés de 80 ou 90 ans, il est vital de «garder une santé sociale», souligne Blaise Willa. «On commence à être isolé. Les enfants s’éloignent, les amis meurent, les référents culturels et religieux partagés s’effacent… On a peur d’être le dernier.»
Et s’investir dans cette relation avec ses parents dans le très grand âge ne va pas toujours de soi, pour des sexagénaires ayant eux-mêmes fait leur vie. «Le soutien à des parents vieillissants peut entraîner des conflits de loyauté: qui doit-on prioriser entre son conjoint, ses enfants, ses parents?» pointe Valérie Hugentobler. Sans compter une possible inversion des rôles: veiller sur ses propres parents est pour le moins paradoxal. Par ailleurs, très souvent, ces liens humains se transforment sans qu’on le dise en prise en charge de la dépendance, un rôle rarement conscientisé. «Parfois, il y a une chute ou un AVC, et la situation de vie du parent change du jour au lendemain, impliquant un nécessaire soutien. Mais généralement cela se met en place petit à petit, au fil du temps, de manière insidieuse, jusqu’à devenir une charge importante, voire lourde», explique la professeure.
Enfin, cette situation voit s’affronter deux normes. Car qui est responsable de la prise en charge? A-t-on tout simplement le choix de devenir ou non un·e aidant·e? «Nous avons développé un État social qui doit rendre nos existences plus viables, nous permettre de faire face aux risques de la vie de manière collective, à travers la mise en place notamment des assurances sociales. Et puis, dans cette phase de vie, surgit ce discours moral, naturalisant, essentialisant, selon lequel il serait ‹normal› de s’occuper de ses parents, surtout quand on est une femme!» soulève la professeure lausannoise. Très souvent, le rôle d’aidante est une assignation sociale qu’on ne peut pas remettre en question sous peine d’être un «mauvais enfant». Ce discours ne cacherait-il pas plutôt une faiblesse de nos structures collectives, bien obligées, de fait, de se reposer sur les aidantes, et sur la sphère familiale?
Le travail effectué peut se révéler ingrat, notamment lorsque cette période de vie fait naître l’espoir de changer ou de réparer une relation difficile avec ses parents.
Pour sortir de l’impasse, la chercheuse appelle à se questionner sur le sens de cet investissement et sur les relais à mobiliser. «Les raisons qui motivent cette aide peuvent être multiples. On peut le vivre plus ou moins bien, avoir envie de s’investir et réussir à concilier cela, ou ressentir cet investissement comme une charge ou une contrainte, tant en termes de temps qu’émotionnellement. Souvent, une discussion au sein de la famille est utile. Avec qui partager cette charge?» Finalement, sur le plan collectif, l’enjeu pour les aidants est de pouvoir s’appuyer sur d’autres formes de soutien, car solidarité familiale et interventions de professionnels peuvent se concilier. «L’idéal», explique l’experte, «serait de déléguer les tâches qu’on ne veut ou qu’on ne peut pas faire pour garder de la disponibilité pour investir le relationnel.»
Vous aidez vos parents âgés?
Quelques conseils
- Renseignez-vous sur les aides existantes dans votre canton.
- Planifiez ce temps de manière fixe dans votre agenda.
- Organisez une supervision psychique individuelle ou familiale.
- Interrogez le rôle d’aidant au sein de votre famille: qui s’investit? Pour combien de temps? Des choix à rediscuter régulièrement.
- Si possible, redonnez un projet à vos parents. Raconter sa vie à un biographe? Prendre soin d’un animal?