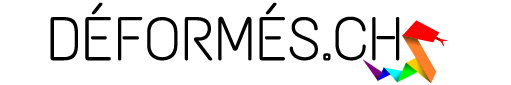L’extension du domaine du soin
Ils et elles ont été au coeur de la crise. Les métiers du soin et de l’aide à la personne se sont retrouvés sous les projecteurs. Car soudain, il y a un an, nos économies ont fait mine de découvrir qu’elles ne pouvaient pas fonctionner sans le soin médical, bien sûr, mais aussi tous ces métiers du «care» (voir encadré): enseignant·e, responsable de crèche, homme ou femme de ménage… Mais aujourd’hui, qu’en avons-nous appris?
Sur le terrain, les soignants sont formels: «Il n’y a aucun changement concret», affirme Enrico Borelli, coresponsable de la branche des soins du syndicat Unia. Constat corroboré par Sophie Ley, présidente de l’Association suisse des infirmières et des infirmiers (ASI): «Il y a eu une prise de conscience dans la population, mais le politique n’a pas suivi. La pandémie n’a pas foncièrement changé les choses.»
Comme d’autres métiers du care, les infirmier·e·s – profession majoritairement féminine – demandent de la reconnaissance. L’initiative populaire «Pour des soins infirmiers forts» arrive d’ailleurs en fin de processus parlementaire au courant du mois de juin. Lancée en 2017, elle compte quatre revendications majeures: mieux financer la formation, améliorer les conditions-cadres, inscrire les soins infirmiers dans la Constitution, faciliter l’activité libérale. En Suisse, comparés aux salaires moyens, les salaires infirmiers hospitaliers sont proportionnellement parmi les plus bas de l’OCDE. Mais la principale revendication des soignant·e·s n’est pas directement financière. «Le vrai problème, ce sont les dotations, soit le nombre de patients attribués à un soignant… souvent bien trop élevé», pointe Sophie Ley. Un constat partagé dans toutes les professions qui impliquent du lien, de l’empathie. «Pour pouvoir porter attention à autrui, il faut avoir du temps. Le coeur du métier, c’est la relation. Si l’on aime son activité et qu’on ne peut pas l’exercer vraiment, c’est une frustration profonde.» Le manque de personnel soignant est une problématique récurrente. Une étude de l’OBSAN, en 2013, montre que 45,9% des infirmiers et des infirmières quittent prématurément le métier, dont un tiers avant l’âge de 35 ans. Le malaise est profond.
Pour les soignant·e·s, la crise est donc l’occasion non pas de défendre le soin, mais de revoir la manière dont on le conçoit. Avec Unia, Enrico Borelli compte ainsi constituer un groupe de travail dans la seconde partie de l’année pour établir un « standard » de la qualité de soins, base de futures initiatives politiques.
L’illusion de l’autonomie
Si les combats politiques ne sont pas encore mûrs, la prise de conscience sociétale a connu un coup d’accélérateur. Tout à coup, ce qui fonde la pensée du care depuis des décennies est devenu évident: «Cette crise a montré nos besoins relationnels, ce qu’inclut le soin dans un sens large», explique Nadja Eggert, à la tête du Centre interdisciplinaire de recherche en éthique (CIRE) de la Faculté de théologie et de sciences de religions de l’Université de Lausanne. «La crise nous montre à quel point nous sommes vulnérables, c’est-à-dire interdépendants: nous vivons en interrelation avec les autres. C’est donc toute l’idée que l’on se fait de notre autonomie qui est fausse: pour vivre et agir en pleine liberté et autonomie, en réalité, nous avons besoin d’un très vaste réseau et de relations qui satisfont nos besoins de base.»
Une notion complexe
Ce care, qui a fait irruption dans nos existences, montre l’intrication de nos fondements intimes et de notre organisation sociale. Il se comprend comme «une vulnérabilité et une activité, un sentiment et un travail», selon la définition de Frédéric Worms, professeur de philosophie contemporaine à l’Ecole normale supérieure de Paris et auteur de plusieurs ouvrages fondamentaux sur le sujet (voir les Ressources du dossier). Faire exister politiquement cette notion est une gageure, parce qu’elle maintient en tension des impératifs contradictoires. Par exemple, celui de préserver la vie et celui de garantir la liberté. Lequel doit primer? La décision de «cloîtrer» de nombreux résident·e·s en EMS a par exemple débouché sur un isolement devenu insupportable. C’est parce qu’il demande constamment ces arbitrages que, pour la philosophie, le soin «dans sa définition complète», et avec ses contradictions inhérentes, peut être vu comme «un apprentissage de la démocratie, de la vie», selon Frédéric Worms.
Exister par le soin
Sur le plan individuel, l’expérience de soigner et celle d’être soigné pourraient même être primordiales pour nous faire prendre conscience de qui nous sommes. «En prenant soin de quelqu’un, on le reconnaît et on le fait Une série de métiers, de tâches, de fonctions est aujourd’hui reconsidérée. En quoi cela se traduit-il par des avancées sociales concrètes? «En prenant soin de quelqu’un, on le reconnaît et on le fait exister». Il y a là une vraie dimension créatrice. A l’inverse, nous existons tous, car, un jour, quelqu’un a pris soin de nous. Toute notre vie, nous sommes à la fois soignés et soignants», observe le philosophe. Nombre d’entre nous ont vécu cette expérience de manière aiguë, ces derniers mois. Comment cela va-t-il changer notre relation aux autres soignant·e·s, aux institutions médicales, aux personnes et aux services qui garantissent, justement, notre autonomie?
Changements sur le temps long
Premier signe d’un changement: la hausse, sensible pour 2020-2021, des inscriptions aux formations dans les domaines de la santé, relevée par l’OBSAN pour les HES de Suisse romande. Pour le reste, certes, certains métiers ou pratiques, comme le télétravail, ont gagné en reconnaissance. Mais les professionnels ne croient pas pour autant à des changements rapides. «Le care implique aussi des rapports de pouvoir, qui ne se modifient pas du jour au lendemain», souligne Nadja Eggert.
D’autres font remarquer que ces changements de conception ont lieu silencieusement depuis des décennies. Ainsi Corinne Schaub, professeure associée en soins infirmiers à la Haute Ecole de santé vaudoise (HESAV) observe depuis plusieurs années «une profonde réorganisation des soins, désormais centrés sur les patients» dans beaucoup d’EMS, «où se développent des lieux de vie, des activités en partenariat avec les familles et qui font sens pour les résidents». En deux décennies, elle a vu le regard «social, biologique, spirituel» s’approfondir sur cette pratique et des soignant·e·s mieux armé·e·s théoriquement. Aujourd’hui, elle constate un intérêt marqué de ses étudiants pour l’intégration des familles dans les parcours de soin. Et la volonté de nombreux soignant·e·s de développer un «maillage de soins» avec d’autres professionnel·le·s et partenaires. «L’idée serait de promouvoir la santé en étant centré sur les proches, les réseaux, les quartiers. L’Eglise y aurait tout à fait sa place!» Une attention collective qui pourrait prévenir les maladies… et la solitude. «Les envies sont là. Mais les budgets ne les permettent pas. Financer de telles collaborations impliquerait une restructuration du système de santé.»
Le care, quand l’empathie est politique
Le mot anglais care peut se traduire par «soin», mais aussi, plus largement, par «attention», «prudence», «bienveillance»… Il sous-entend l’écoute et l’empathie. Le concept du care, développé par les féminismes depuis les années 1970, désigne tout le travail qui veille à la préservation de la vie des autres et de la planète. Culturellement, le care – et le fait d’être attentif aux besoins des autres – a longtemps été associé au féminin et donc dévalorisé. C’est ce qui explique que les professions de ce domaine (prise en charge des personnes dépendantes, malades ou âgées) sont largement exercées par des femmes et sous-payées. Dans la philosophie du care, l’attention et l’empathie ne découlent pas d’un affect particulier, ou d’une «nature» supposée associée à un sexe, mais bien d’une anthropologie: l’humain est compris comme un être de dépendances, sujet à des besoins essentiels et relationnels.
Source : Michaela Moser (en allemand)