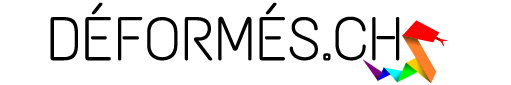Le numérique nous rend-il tous philanthropes?
Fondations, legs, philanthropie, donations? Des termes qui peuvent, pour certains, évoquer le siècle passé. Pourtant, si l’on considère que la philanthropie consiste à donner volontairement pour le bien commun, chacun d’entre nous est un philanthrope! Qui n’a jamais fait un don à la Chaîne du bonheur à la suite d’une catastrophe, pris de son temps pour vendre des chocolats pour une action sociale, ou simplement été bénévole dans une association d’utilité publique? Les fondations ont longtemps incarné la philanthropie, et été porteuses d’innovation et de modernité, notamment dans les milieux protestants (voir "La richesse doit faire sens"). Elles restent aujourd’hui très présentes en Suisse romande, où se concentrent de nombreuses fondations familiales… et des donateurs ou mécènes à l’image de Charles et Anne-Marie Pictet (voir: "Le moteur, c'est toujours l'empathie pour l'autre"). Impossible de savoir combien, parmi ces derniers, agissent par pure conviction religieuse, voire chrétienne; toujours est-il qu’ils comptent parmi les soutiens discrets et réguliers d’ONG protestantes comme l’Entraide protestante (EPER) ou Medair.
Le pouvoir des followers
Mais, en matière de philanthropie, ce sont les réseaux sociaux qui bouleversent la donne. Un exemple? Début janvier, la comédienne australienne Céleste Barber a réuni en quelques jours plus de 30 millions de francs auprès de ses 6,7 millions d’abonnés en ligne en faveur des pompiers, pour lutter contre les incendies qui ravagent l’Australie. Par comparaison, sur toute l’année 2018, les pompiers volontaires australiens ont réuni 530 000 francs de dons.
A l’heure où nombre d’organisations d’utilité publique historiques peinent à réunir des fonds, les stars du web capitalisent efficacement sur leur image pour faire le bien. En 2017, le Youtubeur savoyard Jérôme Jarre s’est fait fort de réunir 2,1 millions de francs au profit de la Somalie. Mais la mise en scène de cet exploit, aux antipodes de la discrétion historique dans l’action philanthropique (voir "Le moteur, c'est toujours l'empathie pour l'autre"), lui a tout de même valu quelques critiques: «Il est arrivé dans la capitale somalienne avec des camions-citernes remplis d’eau, a pris des photos et il est reparti», a dénoncé Jean-Baptiste Matray, directeur de communication de Médecins du monde, dans un dossier de «Télérama» (édition du 4 décembre 2019).
Des projets créatifs et locaux
Aujourd’hui, les associations et ONG ont compris et intégré cette force de frappe des réseaux. Pour faire connaître son site de brocante vintage, Emmaüs a ainsi demandé à des célébrités d’y mettre en vente un objet personnel et de relayer l’info à leur communauté. En 2018, une vingtaine de jeunes réformés vaudois de Lausanne et Epalinges ont souhaité aider des paysans de montagne à Pery-Reuchenette, près de Bienne, au lieu de s’envoler à des milliers de kilomètres pour un lointain projet d’entraide. Ils ont récolté plus de 6000 francs pour leur projet, via un financement participatif en ligne. Cette jeune génération de donneurs change la manière même de penser le don, et la notion de «bien commun», constatent Virginie Xhauflair et Elodie Dessy, deux chercheuses belges auteures d’une étude sur ce que les jeunes apportent à la philanthropie *.
Pluralisme, immédiateté, cohérence
Bien entendu, ces jeunes misent sur la communauté et les outils digitaux. Mais leur vision du collectif dépasse le simple intérêt financier. Ils souhaitent mobiliser l’intelligence collective, le bon sens ou l’esprit civique. En Belgique, un jeune Bruxellois a réussi à mobiliser les habitants de sa ville autour des déchets en partageant des photos d’immondices avec le hashtag #leonothappy (Leo n’est pas content, en référence à l’acteur et militant environnemental Leonardo Di Caprio). Le risque, évidemment, c’est l’éphémère, ou le fait de se contenter de «liker» un post ou de signer une pétition en ligne pour avoir le sentiment d’avoir «fait quelque chose».
Enfin et surtout, les moins de 30 ans veulent l’immédiateté. «Plutôt que de se convertir à la philanthropie au terme d’une carrière professionnelle ayant permis d’amasser de nombreux profits parfois eux-mêmes entachés ‹d’externalités négatives›, les jeunes préconisent d’intégrer l’intérêt général dans toutes leurs décisions, y compris professionnelles», observent Virginie Xhauflair et Elodie Dessy. Autrement dit, autant être cohérent dans ses valeurs ici et maintenant plutôt que d’attendre d’avoir le temps d’y réfléchir. Ainsi le choix d’un métier qui a du sens et d’une entreprise «socialement responsable» serait déjà de la philanthropie… une définition si extensive qu’elle prend le risque de diluer la notion d’engagement.
Coopérer, pas remplacer
Cette tendance à la responsabilité sociale en entreprise est aussi observée dans la philanthropie classique. «Aujourd’hui, l’attitude philanthrope tend à être prioritaire, ou en tout cas paritaire par rapport à la production de valeur. Certains entrepreneurs vont jusqu’à faire des promesses avant même de lancer leur business, s’ils ont du succès ils s’engagent à allouer des ressources à des initiatives philanthropiques. L’idée que les entreprises ne sont pas sans conscience ni moralité, mais porteuses d’une éthique est de plus en plus répandue», observe le professeur Henry Peter, à la tête du Centre en philanthropie de l’Université de Genève.
Par ailleurs, si une majorité de fondations romandes sont particulièrement à la traîne en matière de communication en ligne, la tendance mondiale dans le domaine est aussi à la digitalisation: outils de crowdfunding, développement d’applications pour pouvoir mesurer l’efficacité d’un programme, récolte et partage de données pour optimiser l’action humanitaire… Les fondations historiques cherchent, elles aussi, à repenser leur manière de travailler, se professionnaliser, toucher autrement leur public. «Le fait même que notre centre existe, avec ses cours, sa recherche fondamentale, ses évènements, montre que les philanthropes classiques cherchent à se professionnaliser et à se tourner vers la cité», poursuit Henry Peter. En septembre dernier, le cours sur les enjeux juridiques de la philanthropie a réuni près de 90 étudiants… contre 20 attendus. D’ailleurs, le but des jeunes philanthropes qui se mobilisent massivement pour des causes n’est pas de remplacer les acteurs historiques, mais plutôt de coopérer avec eux, comme le montre l’exemple de «Basel gegen Hunger».
Encourager la culture du don
Toutes ces nouvelles manières de donner ou de s’engager ne «ringardisent» pas pour autant des organismes plus traditionnels, met en garde Etienne Eichenberger, président de la fondation abritante (qui regroupe plusieurs causes) Swiss Philanthropy Foundation et de l’organisme de conseil WISE. «La philanthropie n’a pas besoin d’être innovante pour être utile. Il y a autant de mérite à soutenir des organisations qui fonctionnent depuis des années, comme le Centre social protestant ou Caritas, que des projets plus récents avec des approches innovantes. Ces organismes, acteurs historiques de l’aide sociale, ont un regard légitime sur la souffrance et la façon de la réduire.» Pour lui, l’enjeu n’est pas tellement la démocratisation de la philanthropie. «Tout le monde peut donner en théorie. Ce qui est difficile, c’est d’encourager la culture du don et de la générosité. Comment engager cette conversation avec ses enfants? Comment rester exemplaire soi-même? Combien donner? Historiquement, l’Église pouvait servir de repère sur ces sujets en rappelant chacun à ses devoirs. Dans une société de plus en plus laïque, il faut inventer de nouveaux espaces pour encourager et stimuler la générosité.»
Car donner – et les fondations, ONG et mécènes en savent quelque chose –, c’est aussi souvent s’impliquer dans une problématique, comprendre en nuance ses aspects opérationnels, s’impliquer sur le long terme, construire des relations de confiance avec des partenaires, se retrouver face à des dilemmes éthiques… Des aspects que les nouvelles générations de donateurs n’ont pas fini de découvrir.